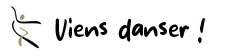L’histoire des claquettes : origines et évolution
L’origine des claquettes a émergé du contexte des esclaves africains arrivés en Amérique au XVIIIe siècle, privés de leurs traditions culturelles, notamment l’utilisation des tambours. Craignant que les tambours ne facilitent les rébellions, les propriétaires d’esclaves les interdisaient. Malgré cela, les esclaves ont trouvé d’autres moyens d’exprimer leur héritage, en imitant les rythmes des tambours avec leurs pieds. Au fil du temps, cette forme de danse est devenue un acte subversif : en utilisant des éléments de mimétisme, les esclaves ont créé une danse qui intégrait des influences africaines et européennes, tout en se moquant subtilement de leurs maîtres. Ce style hybride, né de la fusion de différentes pratiques culturelles, était non seulement un moyen de préserver leur héritage, mais aussi une forme de résistance et de rébellion, permettant aux esclaves de défier l’autorité de manière discrète mais puissante.
Fusion culturelle entre les africains de l’ouest et les irlandais
Dans les années 1830, de nombreux Irlandais fuyant la pauvreté s’installent dans le bidonville de Five Points à New York, et cohabitent avec la population noire. Cette rencontre culturelle a donné naissance à des formes musicales et dansantes uniques, fusionnant les rythmes fluides du jig irlandais et la polyrythmie des percussions africaines. Les mélodies de jig ont été « syncopées » par des musiciens noirs, tandis que les danses afro-américaines, axées sur le mouvement des hanches, se sont mélangées aux danses irlando-américaines, plus rigides. Cette fusion a créé un style de danse hybride, appelé « jigging« , qui se distingue par des mouvements rythmés, limités au bas du corps, avec des sauts et des pas aériens produisant des frottements rapides des pieds. Ce nouveau style de danse a rapidement été reconnu comme une forme d’expression « noire » distincte.

Le Clog et le Hornpipe
Le Lancashire Clog, une forme de danse percussive pratiquée avec des chaussures à semelles de bois, est arrivé en Amérique dans les années 1840 en provenance du Lancashire en Angleterre. En l’espace de quarante ans, il a évolué en divers styles, tels que le Hornpipe, le Pedestal, le Trick, le Statue et le Waltz Clog. Le Clog s’est également fusionné avec des formes de jigging, créant des danses de salon avec des pas formels et des compétitions de solos rapides. Cependant, ces danses manquaient de rythmes syncopés, une caractéristique essentielle qui serait plus tard présente dans des formes comme le Buck and Wing et l’Essence, contribuant au développement du Soft Shoe.
Après 1800
Après les années 1800, les esclaves adoptaient les manières de l’élite blanche du Sud, parodiant la danse des salles de bal, ce qui leur permettait de se moquer de leurs maîtres. Au lieu d’être punis, ils étaient encouragés et des concours de danse furent organisés dans les plantations, avec des gâteaux comme prix, donnant ainsi naissance à la danse du « cakewalk ». Ce style fut ensuite intégré dans les spectacles de minstrels, qui, inspirés de la culture afro-américaine, comportaient des caricatures d’esclaves noirs, comme les personnages stéréotypés créés par l’artiste Daddy Rice. Bien qu’il n’ait pas introduit les claquettes, Rice a influencé leur évolution dans le contexte du minstrel show, notamment avec le personnage de « Jim Crow ». Après la guerre de Sécession, les groupes de minstrels blancs se sont formés, mais un artiste noir, Henry William Lane, alias « Master Juba », a révolutionné la danse en fusionnant rythmes africains et techniques de danse européenne comme le jig et le clog. Il est reconnu pour avoir créé la première forme de danse à claquettes américaine, popularisant ce style dans les années 1840.
Le vaudeville
À la fin du XIXe siècle, le minstrel show s’est progressivement intégré au vaudeville, une forme théâtrale française moins marquée par la race. Cette fusion a permis à de nombreux artistes de transitionner vers cette nouvelle forme de divertissement, souvent perçue comme une extension du minstrel show. Dans les années 1880, des tournées comme celle de la Creole Company ont présenté de nouveaux styles de danse noirs à travers l’Amérique. Des troupes de vaudeville noires, telles que Black Patti’s Troubadours, ont mis en scène des spécialistes du cakewalk et du buck-and-wing. Parallèlement, les spectacles ambulants, les carnavals et les cirques Jig Top ont introduit des danses influencées par le jazz, combinant des pas comme le shuffle, le wing, le drag et le slide avec des mouvements excentriques et le buck-and-wing, une forme précoce de claquettes.

Les sabots d’Hollywood et Bill Robinson
Né en 1878, William Luther Robinson, dit Bill Robinson, commence à danser à seulement cinq ans, marquant le début d’une carrière qui s’étendra sur trois époques de la culture du spectacle américain. Son premier grand succès date de 1900, lorsqu’il remporte un concours de buck dancing au Bijou Theatre de Brooklyn. Le buck dancing, précurseur des claquettes, fusionnait la gigue irlandaise et le clog anglais en ajoutant des syncopes rythmiques. Il utilisait une approche plus plate, rapprochant le danseur du sol, contrairement à la gigue qui se pratiquait sur les orteils. Robinson a brillamment combiné ces deux techniques, posant les bases des claquettes modernes. En 1918, il repousse les limites de la danse en mettant l’accent sur le mouvement horizontal du corps, contrastant avec le style buck-and-wing, qui privilégiait le mouvement vertical. Après une année de performances au Palace Theatre, il entre dans le cercle des grands du vaudeville. Lors d’une représentation, il danse dans un escalier, une innovation qui reçoit un accueil enthousiaste. Robinson intègre bientôt cette danse d’escalier à son répertoire, devenant ainsi une figure clé de la danse de scène.
 La révolution rythmique
La révolution rythmique
Dans les années 1910, les Américains se passionnent pour la danse, notamment le foxtrot, une danse syncopée de ragtime. Des danses dites « animales » comme le Turkey Trot et le Monkey Glide, inspirées de la culture noire, se multiplient. Dans les années 1920, à l’ère du jazz, la danse à claquettes évolue, s’adaptant aux rythmes complexes du jazz, avec des motifs syncopés et de l’improvisation. Elle devient plus rapide, suivant le tempo du jazz. Tandis que les danses de Broadway des années 1920 privilégient des pas simples et des formations élaborées, des chorégraphes comme Clarence « Buddy » Bradley introduisent des éléments de danse noire dans les comédies musicales. Bradley, formé au Hoofer’s Club, simplifie les rythmes des danseurs blancs tout en préservant les accents syncopés du jazz et en intégrant des mouvements du corps inspirés des danses vernaculaires noires. Ses chorégraphies influencent des stars comme Gilda Grey et Ruby Keeler. Les danseurs afro-américains, quant à eux, créent des pas complexes avec des rythmes sophistiqués, posant les bases de la danse à claquettes moderne.
La comédie musicale Shuffle Along (1921) est souvent considérée comme un tournant pour la danse à claquettes jazz sur Broadway. Avec une musique d’Eubie Blake et des paroles de Noble Sissle, elle introduit le « shuffle », un pas de danse rapide et rythmé qui devient l’élément clé de la danse à claquettes. La révolution rythmique de Shuffle Along se poursuit avec des spectacles comme Strut Miss Lizzie (1922), Liza (1922), et Runnin’ Wild (1923), où la version dansée du Charleston et l’utilisation des mains et des pieds pour marquer le rythme deviennent populaires. En 1928, Blackbirds de Lew Leslie consacre la danse à claquettes jazz, avec Bill « Bojangles » Robinson, qui y interprète son fameux « Stair Dance ». Cette performance innovante, dansée sur un escalier avec des rythmes distincts pour chaque marche, marque un tournant dans l’évolution de la danse. Pendant cette période, John Sublett Bubbles, avec son partenaire Ford Lee « Buck » Washington, révolutionne le « rhythm tap » en utilisant des accents de talons et des syncopes inhabituelles, apportant une dimension nouvelle et plus complexe à la danse. Alors que les danseurs blancs apprenaient en studio, les danseurs noirs s’improvisaient et se perfectionnaient dans la rue et les salles de danse, où la compétition était intense et stimulante.
1930-1940 : Le jazz et Broadway
Dans les années 1930 et 1940, la danse à claquettes jazz s’est profondément enracinée dans l’évolution du jazz, notamment le swing, qui mettait l’accent sur des dynamiques rythmiques et une forte improvisation. Ce style de danse s’adaptait parfaitement aux orchestres de swing comme ceux de Count Basie et Duke Ellington, et les danseurs étaient souvent en première ligne, notamment dans des lieux emblématiques comme le Savoy Ballroom de Harlem. C’est également durant cette période que la danse à claquettes a été mise en avant dans des comédies musicales hollywoodiennes, telles que Dixiana (1930) et Swing Time (1936), avec des stars comme Bill Robinson et Fred Astaire. Cependant, à cause de la ségrégation, les danseurs noirs étaient souvent exclus des productions cinématographiques blanches, ce qui a conduit à une distinction dans les styles de claquettes. Les artistes noirs, tels que John Bubbles, ont continué à explorer le rhythm tap avec des improvisations percussives, tandis que les danseurs blancs, comme Gene Kelly, ont adopté un style plus fluide et intégré dans les récits des comédies musicales de Broadway. Parallèlement, des styles comme le « excentrique » et l’« acrobatique » ont émergé, avec des danseurs comme Jigsaw Jackson et Willie Covan, tandis que des ensembles comme Pete, Peaches and Duke ont perfectionné la danse de scène, apportant fluidité et complexité aux performances.
Fred Astaire a joué un rôle crucial dans la popularisation des claquettes, les élevant au rang d’art majeur dans le cinéma hollywoodien. Ses performances dans les comédies musicales, notamment ses duos mémorables avec Ginger Rogers, ont contribué à l’apogée des claquettes. Son style unique, mêlant claquettes, swing et danse classique, a révolutionné la danse à l’écran. Astaire a innové en filmant les scènes de danse en une seule prise et en intégrant la danse à l’intrigue du film, créant ainsi une nouvelle forme d’expression artistique.

1945 : L’après-guerre
Dans les années 1940, après la Seconde Guerre mondiale, la danse jazz américaine a subi une transformation radicale. Les rythmes réguliers du swing ont été remplacés par les harmonies dissonantes et les rythmes complexes du bebop. Les claquettes jazz, autrefois centrées sur les pieds, ont évolué pour incorporer tout le corps, donnant naissance à un style de danse « modern jazz ». Ce nouveau style, moins polyrythmique et sans fers métalliques, est devenu populaire sur Hollywood et Broadway. Cette évolution a marqué une rupture esthétique, où la danse jazz s’est adaptée aux innovations du bebop, devenant ainsi plus fluide et expressive, tout en répondant aux exigences artistiques et narratives du cinéma et du théâtre musical.
1950 : Le déclin des claquettes
Dans les années 1950, les claquettes ont connu un déclin marqué en raison de plusieurs facteurs : la disparition du vaudeville et des numéros de variétés, la dévalorisation de la danse dans les films, et le passage du ballet et de la danse moderne sur les scènes de Broadway. De plus, l’imposition d’une taxe fédérale sur les pistes de danse a entraîné la fermeture des salles de bal, tandis que les combos de jazz, plus intimistes, ont pris le dessus. Dans les années 1960, les opportunités pour les danseurs de claquettes étaient rares, et beaucoup se sont retrouvés sans emploi. Bien que la télévision se soit largement répandue, à part quelques émissions spéciales avec des artistes comme Ray Bolger ou John Bubbles, la danse à claquettes était pratiquement absente des écrans.
1960-1970 : un regain d’intérêt
Le 6 juillet 1963, les claquettes ont connu un renouveau spectaculaire lors du Newport Jazz Festival, grâce à l’événement « Old Time Hoofers » organisé par Marshall Stearns. Ce spectacle a réuni sept maîtres du tap dance, dont Honi Coles, Chuck Green et Baby Laurence, qui ont rappelé au public l’énergie et les rythmes captivants de cet art américain. Ce renouveau s’inscrivait dans un contexte plus large de renaissance du jazz, marquée par la reprise du festival après une pause en 1961, et a contribué à revitaliser l’art du tap dance.
En 1969, Leticia Jay a lancé les « Tap Happenings » au théâtre Bert Wheeler à New York, offrant une plateforme pour des danseurs de tap sous-employés comme Lon Chaney et Jimmy Slyde. Ces sessions informelles ont été suivies par « The Hoofers », une production à succès au Mercury Theatre, puis à Broadway en 1970. Cette période a ravivé l’intérêt pour le tap dance, alimenté par un désir croissant d’apprendre cette discipline.
Au milieu des années 1970, des danseurs plus jeunes, dont de nombreuses femmes blanches, ont commencé à se tourner vers les vétérans pour apprendre les techniques du tap dance. Ce changement a permis aux claquettes de s’imposer sur la scène de concert et de devenir une forme d’art respectée. Des documentaires comme « Jazz Hoofer: The Legendary Baby Laurence » ont contribué à sa renaissance. Un moment phare a été le festival « Steps in Time » en 1979, qui a réuni des légendes du tap pour célébrer l’héritage de la danse, marquant un tournant dans son évolution artistique.

1980 : la renaissance
Dans les années 1980, l’intérêt pour le tap dance a connu une véritable renaissance. En 1980, le documentaire de Michael Blackwood, « Tapdancin' », mettait en lumière des danseurs vétérans comme les Nicholas Brothers, qui créaient des numéros impressionnants pour captiver le public. En 1981, « Sophisticated Ladies », un hommage à Duke Ellington avec Gregory Hines, a fait son apparition à Broadway, suivi par la comédie musicale « Tappin’ Uptown » en 1982, à la Brooklyn Academy of Music, avec Honi Coles.
La scène du tap dance a explosé avec des festivals à travers le pays, des films comme « White Nights » (1985), « The Cotton Club » (1984) et « Tap » (1989), et des productions de Broadway telles que « The Tap Dance Kid » (1985) et « Black and Blue » (1989). À la télévision, l’émission « Tap Dance in America » présentée par Gregory Hines a joué un rôle clé pour introduire le tap dance au grand public.
En 1986, le spectacle « Sole Sisters » à La Mama, dirigé par Constance Valis Hill, mettait en scène des danseuses de tap, jeunes et vétéranes, sur un pied d’égalité. Sur la côte Ouest, Lynn Dally, avec son Jazz Tap Ensemble, fusionnait danse moderne et tap jazz, tandis que Brenda Bufalino, sur la côte Est, a créé l’American Tap Orchestra, combinant danse et musique en concert. Dally et Bufalino ont été des figures majeures dans cette renaissance, en introduisant de nouvelles formes d’interaction entre danse et musique jazz.
Les claquettes après les années 1990
Dans les années 1990, les formes de danse percussive, notamment le stepping, ont gagné en popularité, enracinées dans les traditions afro-américaines et afro-irlandaises. Le stepping, dansé par des jeunes afro-américains en formation, associe des mouvements rapides de frappes corporelles au rythme du hip-hop et du gospel. Né au début du XXe siècle parmi les vétérans noirs de la Première Guerre mondiale dans les universités, il a évolué pour inclure des influences modernes comme le hip-hop. Le stepping est caractérisé par l’improvisation, des rythmes complexes et une forte composante percussive. Ce style s’est surtout développé dans les fraternités noires, devenant un élément central des rituels d’initiation. Le film School Daze de Spike Lee (1988) a permis de populariser ce style.
En 1996, deux spectacles ont marqué l’évolution des traditions de danse percussive. Riverdance a révolutionné la danse irlandaise traditionnelle, la modernisant avec des décors spectaculaires et une chorégraphie innovante de Michael Flatley, qui mélangeait danse irlandaise et flamenco. Ce spectacle a transformé l’image de la danse irlandaise et l’a rendue attrayante à un public mondial. La même année, Bring in ‘da Noise, Bring in ‘da Funk, créé par Savion Glover, a mis en avant le tap dance en ancrant ses racines dans l’identité afro-américaine. Ce spectacle, qui alliait claquettes et rap, a redonné de la popularité aux claquettes, unifiant histoire, rythme et culture. Il a remporté un Tony Award et a marqué le renouveau des claquettes en les inscrivant dans un contexte moderne et urbain.
Les années 1990 ont vu les claquettes évoluer grâce à l’utilisation de nouvelles technologies pour amplifier les sons et introduire des rythmes innovants, ce qui a permis à cette forme d’art de se renouveler tout en respectant ses traditions.

Les claquettes de nos jours …
Les claquettes modernes, bien que relativement récentes, ont une histoire plus longue, ancrée dans des traditions orales qui rendent difficile la documentation de leurs débuts. Lorsque les premiers danseurs ont commencé à pratiquer cet art, ils ignoraient qu’ils posaient les bases d’une forme de danse reconnue et célébrée. À l’origine, il n’était pas prévu que les claquettes deviennent la tradition riche et légitime qu’elles sont aujourd’hui. Leur évolution a défié les attentes, et les vies des danseurs ont incarné la résilience qui a permis cette transformation.
Au fil des dernières décennies, l’intérêt pour les claquettes a grandi. Les avancées technologiques ont rendu cette forme de danse plus accessible, permettant à chacun de trouver des ressources et de rencontrer d’autres passionnés. Internet a facilité la documentation et la diffusion de vidéos de performances. Aujourd’hui, cet art bénéficie d’une reconnaissance accrue grâce à ces nouvelles perspectives et à la visibilité qu’elles lui apportent.