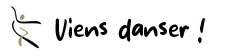Origines et histoire du quickstep
Le quickstep est aujourd’hui une danse de salon rapide, élégante et joyeuse, mais son parcours pour en arriver là est fascinant. Cette page retrace l’histoire du quickstep, depuis ses premières influences jazz et afro-américaines jusqu’aux pistes de compétition modernes. Explorez les origines du quickstep et découvrez d’où vient le quickstep. Vous découvrirez également la naissance du quickstep en Angleterre dans les années 1920, ainsi que l’évolution du quickstep au fil des décennies, entre tradition et innovation technique.
Le quickstep, entre entre foxtrot et Charleston
Les racines du quickstep plongent dans l’âge du jazz et les danses afro-américaines du début du XXème siècle. Il tire directement son origine du foxtrot, une danse née aux États-Unis en 1914, et du charleston, la célèbre danse jazz des années 1920. Concrètement, le quickstep est né de la fusion de ces influences américaines et anglaises.
A sa création, le foxtrot se dansait sur des musiques de ragtime et de blues, et pouvait être exécuté à des tempos très variés, tantôt lents tantôt rapides. Durant les années folles, les orchestres de jazz accéléraient souvent le tempo des foxtrots jusqu’à environ 180 battements par minute, rendant les grands pas lents du foxtrot difficiles à tenir. Ce contexte musical et rythmique a préparé le terrain pour la naissance du quickstep.
Le charleston, autre danse afro-américaine, voit le jour aux États-Unis en 1923 et déferle rapidement sur la scène mondiale dans les années 1920. Son style endiablé, coups de pied, mouvements de genoux et rythmes syncopé, en fait une danse solo spectaculaire très en vogue à l’époque des « années folles ». La mode du charleston traverse l’Atlantique et influence directement l’évolution du quickstep naissant, en apportant au foxtrot rapide une dose d’exubérance et de fantaisie typiquement américaine
1927, naissance officielle du quickstep en Angleterre
Au milieu des années 1920, l’Angleterre s’enthousiasme à son tour pour les rythmes venus d’Amérique. En 1925, une véritable « fièvre du Charleston » s’empare du public britannique. Des professeurs et danseurs anglais cherchent alors à revitaliser le foxtrot en y intégrant certains mouvements de Charleston, tout en conservant le style élégant d’une danse de salon. Ils élaborent ainsi une version rapide du foxtrot, parcourant la piste sans les coups de pied acrobatiques du Charleston, qu’ils baptisent d’abord « Quick Time Foxtrot and Charleston »
Deux ans plus tard, en 1927 à Londres, le quickstep fait son entrée officielle dans le milieu de la danse de salon. Lors des prestigieux Star Championships (championnat du monde de danse organisé par le magazine The Star) au Royal Albert Hall, le couple anglais Frank Ford et Molly Spain présente une version du Quick Time Foxtrot and Charleston adaptée en danse de couple, sans les brusques mouvements de genoux caractéristiques du Charleston. Leur démonstration fait sensation, et cette nouvelle danse est aussitôt adoptée puis standardisée sous le nom de plus simple de « quickstep ».

Le quickstep devient une danse officielle de compétition en 1929
En 1929, le quickstep reçoit sa consécration officielle. Cette année-là se tient à Londres la célèbre « Great Conference », réunissant les experts de l’Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) pour standardiser les danses du moment. Lors de cette conférence, une résolution établit clairement la liste des danses standards de compétition (valse lente, tango, slow fox, quickstep, …) en fixant pour chacune un tempo et des figures de base. Le quickstep, désormais distinct du foxtrot, est reconnu comme l’une des danses modernes de ballroom. À partir de là, il intègre systématiquement les programmes des compétitions de danse de salon au Royaume-Uni puis en Europe.Les années 30 : l’âge du swing et du raffinement
Dans les années 1930, le quickstep s’installe solidement dans le paysage des danses de salon, mais il n’est pas figé : il évolue rapidement sous l’influence des modes musicales et de la créativité des danseurs. En Angleterre, il conserve sa place dans les compétitions tout en se nourrissant de l’énergie des orchestres swing et big band venus des États-Unis. Les musiques de Duke Ellington, Benny Goodman ou Count Basie donnent au quickstep une nouvelle pulsation, plus souple et plus « swinguée », qui inspire des mouvements plus fluides et moins strictement marchés qu’à ses débuts.
C’est aussi dans cette décennie que certains danseurs commencent à glisser dans leurs chorégraphies des pas issus d’autres danses en vogue, comme le Lindy Hop ou le Shag, tout en restant dans le cadre élégant du ballroom. Le quickstep gagne ainsi en variété rythmique et en vivacité. Sur les pistes de compétition, il devient la danse qui clôture souvent les programmes, un final éclatant où les couples donnent toute leur énergie.
Dans les années 1930, la technique du quickstep se précise et s’affine pour donner à la danse l’allure que l’on reconnaît aujourd’hui.
Au début de la décennie, il reste encore très proche du foxtrot rapide : les déplacements sont assez plats, les pas majoritairement glissés, et les variations rythmiques peu nombreuses. Mais à mesure que la décennie avance, les professeurs de danse britanniques travaillent à clarifier la posture, la connexion et la qualité de mouvement.
Les danseurs adoptent progressivement une posture plus haute, avec un maintien constant du cadre de danse pour renforcer l’élégance. On développe la technique du rise and fall – cette montée et descente subtile du corps – afin de donner plus de rebond et de fluidité aux enchaînements rapides. Les chassés deviennent plus nets, et les pas bloqués (lock steps) apparaissent comme une marque de fabrique du style : ils permettent de conserver la vitesse tout en restant en contrôle.
C’est aussi à cette époque que les danseurs commencent à jouer davantage avec le rythme, en alternant temps lents, rapides et syncopés. Les influences swing apportent une petite touche de légèreté supplémentaire : certains couples introduisent des mini-sauts ou de brefs décollés du sol, bien plus modestes que les bonds spectaculaires qui apparaîtront dans les années 1950, mais déjà porteurs de ce côté bondissant qui deviendra l’âme du quickstep.

Les années 40 : danser pour garder le moral
Dans les années 1940, la Seconde Guerre mondiale bouleverse profondément la vie sociale et, avec elle, le monde de la danse. Les grandes compétitions internationales s’interrompent, les salles de bal se vident ou se transforment en lieux de rassemblement pour les soldats. Pourtant, le quickstep ne disparaît pas : il se réinvente dans un contexte où la danse devient à la fois un exutoire et un moyen de garder le moral.
En Angleterre et aux États-Unis, les orchestres qui continuent de jouer s’adaptent aux contraintes : effectifs réduits, répertoires plus simples, mais un rythme toujours entraînant. Les musiques swing restent très populaires, et le quickstep, avec son énergie bondissante, sert de « remède » aux tensions de l’époque. Dans les bals organisés pour les militaires et les civils, il est souvent dansé sur des tempos légèrement plus lents qu’avant-guerre, pour s’adapter à des pistes plus petites et à des danseurs moins entraînés.
La guerre favorise aussi les échanges culturels : les soldats américains stationnés en Europe font découvrir le Lindy Hop et le Jitterbug, dont certains mouvements légers ou syncopés influencent subtilement le style quickstep. Bien que la danse conserve sa structure standard, ces contacts internationaux laissent une empreinte : après 1945, les compétitions reprennent avec des couples qui intègrent une meilleure musicalité swing et un style plus détendu dans leurs quicksteps.

Les années 50 : l’ère des « Tricksteps » spectaculaires
Dans les années 1950, le quickstep connaît une véritable métamorphose. La guerre est terminée, les compétitions internationales reprennent, et l’atmosphère est à la créativité et à la modernisation. Les couples de danseurs ne se contentent plus de reproduire la version « sage » des années 30-40 : ils cherchent à impressionner par la vitesse, la virtuosité et la personnalité.
C’est dans cette décennie que l’on voit apparaître des éléments spectaculaires qui vont marquer l’identité moderne du quickstep. Des champions comme Harry Smith-Hampshire et Doreen Casey, ou encore Bill et Bobbie Irvine, introduisent dans leurs chorégraphies de petits sauts synchronisés, des « hops », des changements brusques de direction et même le fameux mouvement de pendule (balancement des jambes d’avant en arrière). Inspirés en partie des claquettes et du Charleston, ces ajouts donnent au quickstep un côté plus espiègle et athlétique.
Ce style pétillant lui vaut même, dans certains cercles londoniens, le surnom amusé de « Trickstep » : un quickstep plein de petits « trucs » techniques pour surprendre le public et les juges. La musicalité évolue aussi : les danseurs commencent à exploiter davantage les contretemps et les demi-temps, remplissant chaque mesure de pas rapides qui accentuent l’effet de vitesse sans que le tempo musical ait besoin d’accélérer.
Les années 60 à 80 : la maturité technique et l’élégance aérienne
Dans les années 1960 à 1980, le quickstep entre dans une phase de maturité technique. Les bases posées dans les années 50 sont désormais acquises : sauts, lock steps, variations rythmiques rapides font partie intégrante du style. La priorité devient alors la qualité d’exécution et la précision du cadre.
Durant les années 60, les champions britanniques, comme Len Scrivener ou Anthony Hurley et Fay Saxton, affinent le travail du haut du corps : la posture reste haute et élégante, même dans les séquences rapides, et le contact entre partenaires est irréprochable. Le quickstep se danse désormais avec un mouvement continu, presque comme si le couple flottait au-dessus de la piste. Les « bondissements » hérités du Charleston sont plus intégrés, donnant un style fluide plutôt que segmenté.
Dans les années 70 et 80, la danse s’internationalise : l’Australie, le Japon, l’Italie, l’Allemagne deviennent de grandes nations de danse sportive. Des couples comme Marcus et Karen Hilton (actifs surtout à partir des années 80) imposent une précision quasi chirurgicale : chaque pas, chaque montée et descente est calculé pour être parfaitement synchronisé à la musique. La vitesse reste impressionnante, mais le style devient encore plus aérien et raffiné.
A cette époque, les compétitions internationales codifient encore plus strictement les figures autorisées, tout en laissant place à des interprétations personnelles dans la musicalité et l’énergie. Le quickstep devient ainsi la danse de signature du programme standard : rapide, joyeux, mais toujours porté par l’élégance et la maîtrise technique absolue.

Depuis les années 90 : la virtuosité athlétique
A partir des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, le quickstep atteint un niveau athlétique et artistique impressionnant.
Les techniques héritées du passé sont poussées à leur maximum : le cadre reste solide, les déplacements sont fluides et rapides, mais la densité des pas dans chaque mesure est bien plus grande qu’avant.
Les premiers quicksteps se comptaient surtout en alternance de slows et de quicks. Mais les compétiteurs ont peu à peu enrichi la rythmique en ajoutant des demi-temps supplémentaires. A la fin du XXème siècle, les chorégraphies avancées comportaient fréquemment des séquences comptées « quick-and-quick-and-quick-quick-slow », avec des pas très accélérés sur des durées d’un demi-temps. Ces syncopes complexes contribuent à l’augmentation globale de la vitesse perçue du quickstep moderne par rapport à son ancêtre : le tempo musical n’a pas tellement changé depuis les années 1920, mais la densité des pas, elle, s’est accrue grâce à ces subdivisions rythmiques supplémentaires. Autrement dit, les danseurs actuels casent plus de pas et d’actions dans le même laps de temps, rendant la danse encore plus rapide et époustouflante visuellement.
Les champions modernes, comme Marcus et Karen Hilton, puis Arūnas Bižokas et Katusha Demidova, ou Mirko Gozzoli et Alessia Betti, perfectionnent la connexion et la musicalité au point de transformer le quickstep en un véritable numéro de scène. La qualité des montées et descentes (rise & fall) est millimétrée, les accélérations et ralentis sont parfaitement contrôlés, et les sauts sont synchronisés au centième de seconde.
Aujourd’hui, le quickstep est presque toujours la dernière danse du programme standard en finale : c’est le « grand feu d’artifice » qui clôture le spectacle. Les couples y montrent toute leur endurance, car après plusieurs danses lentes et intenses, il faut encore livrer une minute et demie de pure vitesse avec un sourire impeccable. Dans les compétitions de haut niveau, un quickstep réussi se mesure autant à la précision technique qu’à la capacité de faire passer une joie communicative au public.