Les origines et l’histoire du street jazz
Les racines du jazz dansé : des plantations au théâtre (XVIIe-1960)
Les fondations africaines et afro-américaines (XVIIe-XIXe siècles)
L’histoire du street jazz commence bien avant le XXe siècle, dans les cales des navires négriers qui transportaient des millions d’Africains vers le Nouveau Monde. Ces hommes et femmes déportés emportaient avec eux un héritage culturel riche, notamment leurs traditions de danse et de musique, qui allaient profondément transformer la culture américaine.
Les danses africaines se caractérisaient par une polyrythmie complexe, une importance accordée à l’improvisation, et surtout une conception du corps radicalement différente de celle des danses européennes. Là où la danse classique européenne valorisait la verticalité, l’élévation et la rigidité du torse, les danses africaines célébraient le mouvement du bassin, la flexion des genoux, le contact avec la terre, et l’isolement de différentes parties du corps. Ces principes fondamentaux se retrouveront dans toutes les danses jazz.
Dans les plantations du Sud des États-Unis, malgré les tentatives d’interdiction, les esclaves préservaient leurs pratiques culturelles lors de rassemblements clandestins. Les « ring shouts » en sont l’exemple le plus documenté : ces danses circulaires religieuses, où les participants tournaient dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en frappant le sol du pied, combinaient des éléments africains et chrétiens. Le corps penché en avant, les pieds traînant au sol, les danseurs créaient des polyrythmies avec leurs pas, leurs battements de mains et leurs chants. Les esclaves développaient également des danses de divertissement lors des rares moments de repos. Le « buck dancing » et le « juba » utilisaient le corps entier comme instrument de percussion, anticipant les claquettes. Cette période voit aussi naître les « field hollers » et work songs, formes vocales qui influenceront directement le blues puis le jazz.
L’émergence du jazz et de ses danses sociales (1890-1920)
La fin du XIXe siècle marque un tournant décisif. À La Nouvelle-Orléans, creuset culturel unique où se mêlaient influences françaises, espagnoles, caribéennes et africaines, naît la musique jazz. Dans des lieux comme Congo Square, l’un des rares espaces où les Noirs pouvaient se rassembler légalement pour danser et jouer de la musique, se forge une nouvelle esthétique musicale et corporelle. Le ragtime, style musical précurseur du jazz popularisé par Scott Joplin, inspire immédiatement de nouvelles danses. Le « cakewalk », d’abord danse de parodie dans les plantations où les esclaves imitaient ironiquement les manières des maîtres blancs lors des bals, devient une sensation nationale dans les années 1890. Avec ses pas exagérés, son dos cambré et ses mouvements théâtraux, le cakewalk introduit dans la culture populaire américaine une gestuelle issue de la culture noire.
Cette période voit exploser une créativité chorégraphique sans précédent dans les communautés afro-américaines. Le « turkey trot », le « grizzly bear », le « bunny hug » et d’autres danses animales scandalisent la bonne société tout en conquérant les pistes de danse. Ces danses, considérées comme vulgaires par les élites car impliquant un contact corporel étroit entre partenaires, reflètent une libération progressive des mœurs.
Les spectacles de minstrel, bien que profondément problématiques car basés sur des stéréotypes racistes, jouent paradoxalement un rôle dans la diffusion des danses afro-américaines. Des artistes noirs comme Bert Williams et George Walker parviennent à transformer ce médium pour y introduire une authenticité culturelle, tout en devant naviguer dans un système raciste. Le vaudeville offre également une plateforme, certes limitée, pour les danseurs noirs talentueux. Au sortir de la Première Guerre mondiale, le Charleston explose dans les années 1920. Né dans les communautés noires de Charleston, en Caroline du Sud, cette danse énergique avec ses mouvements de jambes caractéristiques, ses genoux tournés vers l’intérieur et ses bras oscillants, devient le symbole de l’ère du jazz. Elle incarne la rébellion des jeunes générations contre les conventions victoriennes et marque l’entrée définitive du jazz dansé dans la culture mainstream.
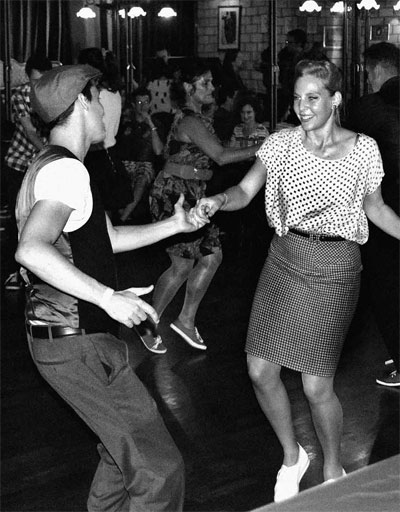 L’âge d’or du swing et des danses sociales (1920-1940)
L’âge d’or du swing et des danses sociales (1920-1940)
Les années 1920 et 1930 représentent l’apogée des danses jazz sociales, avec Harlem comme épicentre créatif. Le quartier noir de New York devient le centre culturel afro-américain par excellence, attirant artistes, intellectuels et fêtards de toutes origines.
Le Savoy Ballroom, ouvert en 1926 sur Lenox Avenue, devient le temple de la danse swing. Contrairement à la plupart des établissements de l’époque, le Savoy accepte une clientèle mixte racialement, bien que cette intégration reste limitée et souvent tokeniste. C’est sur son parquet légendaire, capable d’accueillir 4 000 personnes, que naît le Lindy Hop, nommé en l’honneur du vol transatlantique de Charles Lindbergh. Le Lindy Hop représente une révolution chorégraphique. Cette danse en couple combine la structure du charleston et du foxtrot avec des éléments d’improvisation africaine et des figures aériennes spectaculaires. Les danseurs comme Frankie Manning, Norma Miller et les membres des Whitey’s Lindy Hoppers (troupe résidente du Savoy) développent un vocabulaire technique impressionnant : les aerials (figures aériennes), les slides, les breakaways où les partenaires se séparent pour improviser individuellement.
Ce qui rend le Lindy Hop unique, c’est son dialogue constant entre structure et liberté. Contrairement aux danses de salon européennes très codifiées, le Lindy encourage l’improvisation personnelle dans un cadre partagé. Chaque danseur développe son propre style, sa propre « voix » corporelle, reflétant ainsi la philosophie du jazz musical où les solistes improvisent sur une structure harmonique commune. Les « rent parties » dans les appartements d’Harlem, où l’on faisait payer l’entrée pour aider à payer le loyer, deviennent des laboratoires de créativité chorégraphique. Dans ces espaces intimes, loin des regards blancs, les danseurs expérimentent librement, créant des variations régionales et personnelles. Le Big Apple, le Suzy-Q, le Truckin’ émergent de ces sessions improvisées.
La culture des « battles » de danse prend forme dans cette période. Au Savoy, les mercredis étaient réservés aux compétitions, où des équipes rivales s’affrontaient dans des joutes chorégraphiques spectaculaires. Ces battles établissent un modèle de compétition amicale et de surenchère créative qui influencera directement la culture hip-hop des décennies plus tard. L’Apollo Theater offre une autre plateforme cruciale. Sa célèbre Amateur Night devient le tremplin pour d’innombrables talents, tandis que les spectacles professionnels présentent les meilleurs danseurs et chorégraphes de l’époque. Le format spectaculaire des revues afro-américaines, avec leurs chorus lines synchronisés et leurs numéros solo virtuoses, préfigure les comédies musicales de Broadway.
La transition vers le théâtre et la codification (1940-1960)
Les années 1940 marquent un tournant décisif : le jazz dansé commence sa migration des salles de bal vers la scène théâtrale, des espaces sociaux vers les espaces de représentation. Cette transformation implique une codification et une théâtralisation qui modifieront profondément la nature de la danse jazz.
Katherine Dunham joue un rôle pionnier dans cette transition. Formée en anthropologie à l’Université de Chicago, elle effectue des recherches de terrain approfondies dans les Caraïbes, étudiant les danses d’Haïti, de la Jamaïque et de Trinidad. Dunham développe une technique qui fusionne consciemment les principes des danses africaines et caribéennes avec la formation en danse moderne et ballet. Sa « Dunham Technique » met l’accent sur les isolations du torse, les ondulations de la colonne vertébrale, et l’utilisation du plié parallèle, tous éléments qui deviendront centraux dans le jazz théâtral.
Mais c’est Jack Cole qui est souvent crédité comme le « père du jazz théâtral ». Danseur blanc fasciné par les cultures non-occidentales, Cole étudie les danses indiennes et intègre leurs principes d’isolation corporelle avec l’énergie du jazz afro-américain et l’esthétique du burlesque. Sa technique, développée dans les studios d’Hollywood des années 1940, est caractérisée par des isolations précises des épaules, des hanches et de la cage thoracique, des changements de direction rapides, et une qualité de mouvement qui alterne entre l’explosion et le contrôle.
Cole chorégraphie pour des films hollywoodiens et travaille avec des stars comme Rita Hayworth, Marilyn Monroe et Jane Russell. Il forme également plusieurs générations de danseurs qui deviendront eux-mêmes des figures majeures, dont Bob Fosse et Gwen Verdon. Sa méthode d’enseignement est notoirement exigeante, insistant sur la précision technique et la qualité d’exécution.
Bob Fosse émerge dans les années 1950 comme la voix chorégraphique la plus distinctive de Broadway. Son style, immédiatement reconnaissable, combine des éléments de vaudeville, de burlesque et de jazz urbain. Les épaules rentrées, les mains en « jazz hands » retournées, les hanches isolées, les chapeaux melon et les cannes, les mouvements suggestifs mais stylisés : Fosse crée un vocabulaire qui définira l’esthétique de la comédie musicale américaine pendant des décennies. Des spectacles comme « The Pajama Game », « Damn Yankees », « Sweet Charity » et « Chicago » établissent sa signature. Jerome Robbins apporte une autre perspective, fusionnant ballet, jazz et théâtre pour créer des œuvres narratives puissantes. « West Side Story », créé en 1957, représente l’apogée de cette synthèse, utilisant le jazz dansé pour exprimer les tensions sociales et raciales de l’Amérique urbaine.
Cette période voit également l’émergence de studios de danse spécialisés en jazz. Luigi (Eugene Louis Faccuito), survivant d’un accident qui le laisse paralysé d’un côté, développe une technique jazz basée sur l’étirement et la sensation de « reaching » qui influence profondément la pédagogie du jazz. Ses classes à New York deviennent légendaires, attirant danseurs professionnels et célébrités. Matt Mattox, autre disciple de Jack Cole, systématise encore davantage la technique jazz, créant des exercices progressifs qui permettent un apprentissage structuré. Sa méthode « freestyle jazz » sera enseignée internationalement, particulièrement en Europe.
Cependant, cette institutionnalisation comporte une dimension problématique : alors que le jazz dansé trouve ses racines dans la culture afro-américaine, sa codification et sa commercialisation à Broadway sont largement contrôlées par des chorégraphes blancs. Les danseurs noirs, bien que présents et souvent brillants, restent sous-représentés dans les rôles principaux et dans les positions de pouvoir créatif. Cette tension entre appropriation culturelle et échange artistique légitime traverse toute l’histoire du jazz dansé. À la fin des années 1950, le jazz théâtral est devenu une discipline établie, enseignée dans les studios, présentée sur les plus grandes scènes, immortalisée au cinéma. Mais simultanément, dans les rues et les communautés urbaines, de nouvelles formes de danse jazz émergent, portées par les révolutions musicales du funk, de la soul et bientôt du hip-hop. Le fossé commence à se creuser entre le jazz des studios et le jazz des rues, entre la tradition théâtrale et l’innovation urbaine spontanée.
Cette période de transition établit néanmoins des fondations techniques et esthétiques cruciales. Les principes d’isolation, de coordination complexe, de musicalité précise, et d’expression théâtrale développés durant ces décennies formeront le socle sur lequel le street jazz contemporain construira sa propre identité, tout en se reconnectant avec l’énergie spontanée et l’innovation des danses sociales dont il est issu.

L’explosion de la culture urbaine (1960-1980)
Pendant que le jazz théâtral se consolidait à Broadway, une révolution culturelle et chorégraphique prenait forme dans les rues des métropoles américaines. Les années 1960-1980 voient l’émergence d’une nouvelle culture de danse urbaine, portée par des mutations musicales radicales et par l’affirmation identitaire des communautés afro-américaines et latinos dans le contexte du mouvement des droits civiques.
Le funk et la soul : nouvelles influences musicales
Le milieu des années 1960 marque l’avènement du funk et de la soul, genres musicaux qui transforment radicalement le paysage de la danse. James Brown, figure tutélaire de cette révolution, ne se contente pas de chanter : il incarne littéralement le groove dans son corps. Ses performances scéniques, avec leurs footworks complexes, leurs slides, leurs spins et leurs drops spectaculaires, deviennent des modèles pour toute une génération de danseurs.
Le funk se caractérise par un accent sur le premier temps (le « one »), des basses profondes et pulsatives, et des rythmes syncopés qui invitent à un mouvement plus terrestre, plus ancré que le swing des décennies précédentes. La musique de Parliament-Funkadelic, Sly and the Family Stone, The Meters et bien d’autres crée une palette rythmique qui appelle de nouveaux vocabulaires corporels. La soul, portée par des labels comme Motown et Stax, apporte sa propre influence. Les chorégraphies des groupes vocaux comme The Temptations, The Four Tops ou The Supremes, avec leurs pas synchronisés et leurs formations géométriques, influencent les danseurs de rue autant que les chorégraphes professionnels. Cholly Atkins, chorégraphe maison de Motown, développe un style élégant et précis qui marie sophistication théâtrale et authenticité du groove.
Les danses de rue : locking, popping et boogaloo
Sur la côte Ouest, principalement à Los Angeles, naissent dans les années 1960-1970 des styles de danse révolutionnaires qui formeront le socle du street dance.
• Le locking est créé par Don Campbell (Don Campbellock) au début des années 1970. L’histoire raconte que Don, en essayant d’apprendre une danse populaire appelée « the Funky Chicken », n’arrivait pas à exécuter correctement les mouvements fluides. Au lieu d’abandonner, il transforme ses « erreurs » en style : il gèle (« lock ») dans des positions précises, créant des arrêts saccadés sur la musique. Le locking se caractérise par des mouvements amples et énergiques, des « locks » (positions figées), des « points » (gestes de pointer), et une attitude joyeuse, presque comique. Don Campbell forme The Lockers en 1972, groupe qui comprend également Fred « Mr. Penguin » Berry et Toni Basil (qui deviendra célèbre dans les années 1980 avec sa chanson « Mickey »).
• Le popping émerge à Fresno, Californie, développé par Boogaloo Sam (Sam Solomon) et son groupe Electric Boogaloos au milieu des années 1970. Le popping repose sur la contraction rapide et le relâchement des muscles pour créer des « pops » ou « hits » sur le rythme de la musique. Cette technique exige un contrôle musculaire extrême et une isolation corporelle poussée à son paroxysme. Les poppeurs développent des sous-styles comme le waving (création d’illusions de vagues traversant le corps), le tutting (création d’angles géométriques avec les bras inspirés des hiéroglyphes égyptiens), et le strobing (création d’effets visuels de mouvement saccadé).
• Le boogaloo, souvent confondu avec le popping, est en réalité un style distinct caractérisé par des mouvements fluides et roulés des hanches et des jambes, créant une illusion de corps dépourvu d’os. Les Electric Boogaloos perfectionnent ce style, qui se diffuse rapidement dans toute la Californie.
Ces danses de rue partagent plusieurs caractéristiques fondamentales : elles privilégient l’improvisation et l’expression individuelle, se développent dans des contextes sociaux informels (coins de rue, parcs, sessions entre amis), et sont indissociables de la musique funk qui les porte. Elles incarnent aussi une forme de résistance culturelle et d’affirmation identitaire pour des jeunes des quartiers défavorisés.
 L’émergence du hip-hop et du breakdance
L’émergence du hip-hop et du breakdance
À New York, particulièrement dans le South Bronx, une nouvelle culture émerge à la fin des années 1970 : le hip-hop. Cette culture, portée par des DJs comme Kool Herc, Afrika Bambaataa et Grandmaster Flash, comprend quatre éléments fondamentaux : le MCing (rap), le DJing, le graffiti, et le b-boying (breakdance).
Le breakdance, ou breaking, se développe initialement comme une forme d’affrontement ritualisé entre gangs de rue, remplaçant la violence physique par la compétition chorégraphique. Les b-boys et b-girls dansent sur les « breaks » instrumentaux des morceaux funk et soul que les DJs isolent et prolongent en utilisant deux platines. Le breaking se structure autour de plusieurs éléments : le toprock (mouvements debout), le downrock ou footwork (mouvements au sol avec appui sur les mains), les freezes (positions figées en équilibre), et les power moves (mouvements acrobatiques comme les windmills, flares, et headspins). Des crews légendaires comme Rock Steady Crew, fondée en 1977 par Jojo et Jimmy D, puis reprise par Crazy Legs, établissent des standards techniques tout en développant une culture de crew basée sur la loyauté, le respect et l’innovation constante.
Le breaking diffère des autres danses funk de la côte Ouest par son caractère plus acrobatique et compétitif, mais partage avec elles l’importance de l’improvisation, du battle, et de la connexion profonde avec la musique. Les b-boys développent également le concept du « cypher » ou « circle » : les danseurs forment un cercle et chacun entre à tour de rôle au centre pour improviser, encouragé et jugé par ses pairs.
Soul Train et la diffusion médiatique
Si ces danses naissent dans les rues et les communautés locales, leur diffusion nationale et internationale s’accélère grâce à la télévision, et particulièrement grâce à une émission : Soul Train.
Lancée en 1970 par Don Cornelius à Chicago, puis diffusée nationalement à partir de 1971, Soul Train devient rapidement bien plus qu’une simple émission musicale. Chaque samedi, des millions de téléspectateurs découvrent les dernières innovations en matière de danse urbaine. Le format de l’émission, avec son célèbre « Soul Train Line » où les danseurs descendent en couple entre deux rangées pour montrer leurs meilleurs mouvements, crée un espace de performance et de reconnaissance pour les danseurs amateurs. Soul Train démocratise l’accès aux danses urbaines. Des jeunes de tout le pays peuvent voir et apprendre les mouvements à la télévision, créant une culture partagée qui transcende les frontières géographiques. L’émission présente tous les grands styles : le locking (The Lockers apparaissent régulièrement), le popping, le robot, et d’innombrables danses sociales comme le Robot, le Smurf, ou le Prep.
Les danseurs réguliers de Soul Train deviennent des célébrités dans leurs communautés. Des figures comme Damita Jo Freeman, qui introduit le « locking » féminin avec sa propre signature, ou Adolfo « Shabba-Doo » Quiñones, qui deviendra une figure majeure du popping et du locking, gagnent en visibilité. L’émission crée aussi un pipeline vers la carrière professionnelle : plusieurs danseurs de Soul Train transition vers des carrières à Hollywood ou sur scène. L’impact de Soul Train dépasse la simple diffusion technique. L’émission célèbre la culture afro-américaine à une époque où la représentation noire à la télévision reste limitée. Elle présente des corps noirs en mouvement non pas comme objets de curiosité exotique ou de divertissement dégradant, mais comme créateurs de culture, innovateurs, artistes accomplis. Cette validation médiatique contribue à légitimer les danses urbaines comme formes d’art à part entière.
D’autres émissions suivront, comme « American Bandstand » qui intègre progressivement plus de danseurs noirs et de musique soul/funk, ou les apparitions de danseurs dans des variétés comme « The Carol Burnett Show » ou « The Sonny & Cher Comedy Hour ». Mais aucune n’aura l’impact culturel de Soul Train.
Les films et l’expansion culturelle
La fin des années 1970 et le début des années 1980 voient également l’émergence de films qui documentent et dramatisent ces cultures de danse urbaine. « Breakin' » (1984) et « Breakin’ 2: Electric Boogaloo » (1984), bien que souvent critiqués pour leur simplification commerciale, introduisent le breaking et le popping à un public mondial. Ces films, tournés avec de véritables danseurs de rue comme Shabba-Doo et Boogaloo Shrimp (Michael Chambers), capturent l’esthétique et l’énergie des battles de rue. « Beat Street » (1984) et « Wild Style » (1983) offrent des portraits plus authentiques de la culture hip-hop, montrant comment danse, graffiti, DJing et rap forment un écosystème culturel cohérent dans les quartiers défavorisés de New York. Ces films documentent un moment historique où ces cultures, encore largement underground, commencent à percer dans le mainstream.
L’innovation continue dans les communautés
Malgré cette exposition médiatique croissante, l’innovation la plus significative continue de se produire dans les espaces informels. Les coins de rue, les parcs publics, les centres communautaires et les block parties restent les véritables laboratoires chorégraphiques. C’est là que les danseurs expérimentent, fusionnent des styles, inventent de nouveaux mouvements. Cette période voit également l’expansion géographique de ces cultures. Du South Bronx à Los Angeles, de Chicago à Oakland, chaque ville développe ses propres variations stylistiques et ses propres crews légendaires. Cette diversité régionale enrichit le vocabulaire global du street dance, créant un réseau complexe d’influences et d’échanges.
Les années 1960-1980 représentent donc un moment fondateur où les danses de rue atteignent une masse critique, se structurent en styles distincts, gagnent en visibilité médiatique, tout en conservant leur authenticité et leur ancrage communautaire. Cette tension entre underground et mainstream, entre innovation de rue et commercialisation, définira l’évolution du street jazz dans les décennies suivantes.

La fusion : naissance du street jazz moderne (1980-2000)
Les années 1980-1990 marquent un moment charnière où les danses urbaines et le jazz théâtral, jusqu’alors évoluant sur des trajectoires parallèles, commencent à converger pour créer ce qu’on appellera le street jazz. Cette fusion ne se fait pas sans tensions, questionnements identitaires et débats sur l’authenticité, mais elle aboutit à l’émergence d’un nouveau langage chorégraphique hybride qui dominera la culture populaire.
L’intégration des styles urbains dans les studios
Au début des années 1980, les frontières entre la rue et le studio commencent à s’estomper. Les chorégraphes et directeurs de studios, observant l’explosion de popularité des danses funk et hip-hop, réalisent qu’il existe un public avide d’apprendre ces styles dans un cadre formel. Simultanément, des danseurs de rue cherchent à professionnaliser leurs compétences et à accéder aux opportunités commerciales qu’offre l’industrie du divertissement.
Les premiers studios à intégrer ces styles émergent en Californie. Des danseurs comme Shabba-Doo, après le succès des films « Breakin' », commencent à enseigner le popping et le locking dans des studios de danse traditionnels. Ce passage du trottoir au studio nécessite une adaptation : les mouvements doivent être décomposés, analysés, systématisés pour être enseignés de manière progressive. Cette pédagogie formelle transforme inévitablement la nature spontanée et improvisatoire de ces danses. À New York, des studios comme Broadway Dance Center (ouvert en 1984) et Steps on Broadway commencent à offrir des cours de hip-hop aux côtés des classes de ballet, jazz moderne et contemporain. Des pionniers comme Buddha Stretch (qui travaillera plus tard avec Michael Jackson), Henry Link, et Loose Joint introduisent le « hip-hop chorégraphié », une version structurée et reproductible des mouvements de rue, conçue pour être apprise et performée en groupe.
Cette institutionnalisation crée une distinction cruciale entre le « hip-hop freestyle » (l’improvisation de rue dans les cyphers) et le « hip-hop chorégraphié » (des routines préparées pour la scène ou l’écran). C’est dans cet espace du hip-hop chorégraphié, fusionné avec la technique jazz, que le street jazz prend forme. Les enseignants commencent à créer des « warm-ups » qui mélangent les isolations du jazz théâtral avec le groove du funk et du hip-hop. Les exercices de centre incorporent des bounces, des waves, et des attitudes gestuelles issues de la rue. Progressivement, un nouveau vocabulaire technique émerge qui n’est ni purement jazz ni purement hip-hop, mais une synthèse des deux.
 MTV et la révolution des clips vidéo
MTV et la révolution des clips vidéo
L’arrivée de MTV en 1981 bouleverse l’industrie musicale et, par extension, le monde de la danse. Pour la première fois, la musique devient indissociable de l’image en mouvement. Les artistes ont besoin de concepts visuels puissants et de chorégraphies mémorables pour se démarquer. Cette demande crée des opportunités sans précédent pour les chorégraphes et danseurs.
Michael Jackson devient la figure centrale de cette révolution. Son clip « Thriller » (1983), chorégraphié par Michael Peters, établit de nouveaux standards pour ce que peut être un vidéoclip : un mini-film avec une chorégraphie élaborée qui fusionne jazz théâtral, mime, et mouvements urbains. La séquence de danse des zombies devient iconique, copiée par des millions de personnes à travers le monde. Mais c’est avec « Beat It » (1983) et surtout « Smooth Criminal » (1987) que Jackson repousse les limites. Il intègre le popping, le locking, et le breaking dans un style hautement stylisé et théâtral. Son moonwalk, dévoilé lors de la performance de « Billie Jean » en 1983, devient le mouvement le plus célèbre de l’époque, bien qu’inspiré du backslide pratiqué depuis des décennies dans les communautés noires, Jackson le perfectionne et le popularise mondialement. Michael Jackson travaille avec les meilleurs danseurs de rue : il apprend auprès de poppeurs comme Boogaloo Shrimp et de lockeurs, puis traduit ces techniques dans son propre langage corporel unique. Sa gestuelle, les positions de bras angulaires, les rotations de bassin, les freezes soudains, le toucher de chapeau, les crotch grabs, devient un vocabulaire partagé que des millions de jeunes imitent dans leurs chambres et cours d’école.
Janet Jackson continue cette révolution avec des clips encore plus axés sur la danse pure. « Rhythm Nation » (1989), chorégraphié par Paula Abdul puis Anthony Thomas, présente une formation militaire stylisée qui fusionne jazz, hip-hop et discipline synchronisée. « If » (1993) et « That’s the Way Love Goes » (1993) offrent une sensualité contrôlée et un groove profond qui influencent toute une génération de danseuses.
D’autres artistes contribuent à cette esthétique : MC Hammer avec « U Can’t Touch This » (1990) apporte les running man et hammer dance, Bobby Brown introduit le New Jack Swing avec sa gestuelle signature, Paula Abdul elle-même, avec « Straight Up » (1988) et « Cold Hearted » (1989), présente des chorégraphies qui deviendront des références du street jazz.
Les clips vidéo créent un nouveau modèle économique pour les danseurs. Une apparition dans un clip majeur peut lancer une carrière. Des danseurs comme Tina Landon (qui travaillera avec Janet Jackson pendant des années), Travis Payne (collaborateur de longue date de Michael Jackson), et toute une génération de performers trouvent dans l’industrie du clip une plateforme de visibilité et de revenus.
Les chorégraphes qui font le pont
Certains chorégraphes jouent un rôle crucial en servant de pont entre le monde du studio et celui de la rue, entre la technique classique et l’énergie urbaine.
• Paula Abdul incarne parfaitement cette transition. Cheerleader des Lakers, elle possède une formation en jazz et en ballet, mais est profondément attirée par les danses urbaines. Ses chorégraphies pour les Jackson (elle travaille d’abord avec les Jacksons puis avec Janet) fusionnent la précision du jazz théâtral avec le groove et l’attitude du hip-hop. Son travail établit un template : des formations géométriques propres, des isolations précises, mais avec une qualité de mouvement détendue et funky, loin de la rigidité du jazz classique.
• Travis Payne, après avoir commencé comme danseur dans les clips de Lionel Richie et Michael Jackson, devient un chorégraphe majeur dans les années 1990. Il perfectionne l’art de créer des chorégraphies commerciales qui paraissent spontanées et cool tout en étant techniquement exigeantes et reproductibles. Son approche influence profondément les studios de danse à travers le monde.
• Fatima Robinson émerge dans les années 1990 avec un style distinct qui marie sensualité, précision et attitude urbaine. Elle travaille avec Aaliyah, créant des chorégraphies pour « Are You That Somebody » (1998) et « Try Again » (2000) qui définissent l’esthétique R&B de la fin des années 1990. Son style – fluide, ondulant, avec des accents tranchants et une qualité presque liquide – devient extrêmement influent.
• Brian Friedman commence sa carrière comme danseur dans les années 1990 et devient rapidement chorégraphe, travaillant avec Britney Spears, Backstreet Boys et d’autres pop stars. Son style incorpore des éléments acrobatiques, des formations complexes, et une énergie explosive qui repousse les limites de ce que peut être une performance pop.
Ces chorégraphes partagent plusieurs caractéristiques : ils ont une formation technique solide, comprennent les exigences de la caméra et de la production, mais maintiennent une connexion avec l’authenticité et l’énergie des danses urbaines. Ils créent un vocabulaire hybride qui peut être enseigné dans les studios mais conserve une partie de l’âme des danses de rue.
 L’influence du hip-hop sur la technique jazz
L’influence du hip-hop sur la technique jazz
L’intégration du hip-hop transforme radicalement la technique jazz elle-même, créant de nouvelles exigences corporelles et esthétiques.
• Le bounce et le groove : Alors que le jazz classique valorise l’élongation, la légèreté et la verticalité, le hip-hop introduit le bounce – un pli constant des genoux qui crée un mouvement de rebond rythmique. Ce bounce devient fondamental dans le street jazz. Les danseurs doivent maintenir ce groove constant tout en exécutant des mouvements précis des bras et du torse, créant une coordination complexe entre parties supérieure et inférieure du corps.
• Le poids et l’ancrage : Le hip-hop apporte un sens du poids terrestre. Contrairement au ballet qui cherche à défier la gravité, le hip-hop célèbre la connexion au sol. Le street jazz intègre cette qualité : les danseurs descendent leur centre de gravité, utilisent le plié parallèle profond, et créent de la puissance depuis la terre plutôt que depuis l’élévation.
• Les isolations et le contrôle : Si le jazz classique utilisait déjà les isolations, le hip-hop les pousse à un autre niveau. Les chest pops, les shoulder rolls, les head nods deviennent des éléments rythmiques essentiels. Le street jazz exige une capacité d’isolation extrême – bouger une partie du corps de manière indépendante tout en maintenant le groove du reste du corps.
• L’attitude et la projection : Le jazz classique demande une présence scénique, mais le hip-hop apporte une notion d’attitude spécifique – un certain swagger, une confiance décontractée, une capacité à projeter sa personnalité à travers le mouvement. Dans le street jazz, la technique pure ne suffit pas ; il faut danser avec attitude, avec son propre style.
• Les arrêts et la dynamique : Le popping introduit le concept de stops nets et contrôlés. Le street jazz incorpore cette capacité à passer instantanément d’un mouvement explosif à un freeze total, créant des contrastes dynamiques dramatiques. Les danseurs doivent maîtriser un spectre complet d’énergies, du fluide au saccadé.
• Le freestyle et l’improvisation : Alors que le jazz théâtral est principalement chorégraphié, le hip-hop valorise le freestyle. Les cours de street jazz commencent à inclure des sections de freestyle où les étudiants doivent improviser, développant non seulement leur vocabulaire technique mais aussi leur capacité à interpréter la musique spontanément.
La distinction entre jazz traditionnel et street jazz
À mesure que le street jazz se développe, une distinction claire émerge avec le jazz traditionnel, créant parfois des tensions dans la communauté de danse.
• Technique et formation : Le jazz traditionnel insiste sur une formation de base en ballet – le turnout (rotation externe des jambes), les positions codifiées, la technique de pointes pour certains. Le street jazz rejette le turnout systématique, préférant le parallèle, et n’exige pas de formation ballet. Cette différence technique crée deux corps de danseurs distincts avec des capacités et limitations différentes.
• Musicalité : Le jazz traditionnel est souvent dansé sur du jazz musical classique ou sur des arrangements orchestraux. Le street jazz est indissociable du hip-hop, du R&B, du funk, de la pop contemporaine. La musicalité diffère : le jazz traditionnel privilégie souvent les accents mélodiques, tandis que le street jazz se concentre sur les beats, les basses, les hi-hats.
• Esthétique et intention : Le jazz traditionnel cherche souvent une qualité théâtrale, performative, avec des sourires, une présence scénique classique. Le street jazz cultive une esthétique plus cool, plus décontractée, avec une attitude qui vient de la rue. Les expressions faciales sont différentes, le rapport au public est différent.
• Pédagogie : Les cours de jazz traditionnel suivent une structure classique : barre ou warm-up structuré, centre, déplacements, chorégraphie. Les cours de street jazz ont souvent une structure plus libre, commençant directement par le groove, incluant du freestyle, et privilégiant l’apprentissage de chorégraphies commerciales contemporaines.
• Débats d’authenticité : Des tensions émergent autour de l’authenticité. Certains puristes du hip-hop accusent le street jazz de diluer et commercialiser leur culture. À l’inverse, certains danseurs de jazz traditionnel considèrent le street jazz comme techniquement moins rigoureux. Ces débats reflètent des questions plus larges d’appropriation culturelle, de race, et de classe sociale.
• Reconnaissance institutionnelle : Dans les écoles de danse et les compétitions, le street jazz commence à être reconnu comme une catégorie distincte dans les années 1990. Des concours créent des divisions séparées pour « jazz » et « hip-hop » ou « street jazz », bien que les frontières restent floues et débattues.
L’industrie et la professionnalisation
À la fin des années 1990, le street jazz est devenu une industrie. Des conventions de danse comme Jump, Tremaine, 24Seven et Break the Floor attirent des milliers de jeunes danseurs chaque année. Ces conventions offrent des master classes avec les chorégraphes des plus grandes stars, créant un circuit de formation intensif et standardisé.
Les compétitions de danse prolifèrent, avec des catégories dédiées au street jazz. Des shows comme « America’s Best Dance Crew » (qui débutera en 2008) sont en gestation. L’infrastructure pour une industrie complète de la danse commerciale est en place. Cette professionnalisation a des effets ambivalents. D’un côté, elle crée des opportunités économiques pour les danseurs et élève le niveau technique global. De l’autre, elle standardise les styles, favorise certaines esthétiques au détriment d’autres, et peut éloigner la danse de ses racines communautaires et spontanées.
À l’aube du XXIe siècle, le street jazz existe comme une forme hybride mature, enseignée dans des milliers de studios, pratiquée par des millions de personnes, visible dans chaque clip vidéo majeur. Il a trouvé un équilibre, parfois précaire, entre technique et attitude, entre codification et spontanéité, entre commercial et authentique. Les années 2000 verront cette forme se consolider encore davantage, portée par de nouvelles plateformes médiatiques et une nouvelle génération de chorégraphes innovants.

Le street jazz contemporain (2000-aujourd’hui)
Les deux premières décennies du XXIe siècle transforment le street jazz d’un phénomène principalement américain en un mouvement culturel véritablement mondial. L’explosion des plateformes numériques, l’émergence de nouvelles superpuissances de la pop culture, et l’évolution constante des styles musicaux reconfigurent profondément ce paysage chorégraphique.
L’ère des compétitions télévisées
L’année 2008 marque un tournant avec le lancement de « America’s Best Dance Crew » (ABDC) sur MTV. Pour la première fois, la danse urbaine devient le sujet central d’une émission de télé-réalité en prime time. Des crews comme Jabbawockeez, Quest Crew, Kaba Modern et Poreotics deviennent des célébrités, et leurs performances – mélangeant popping, locking, breaking, animation, et tutting dans des productions hautement théâtralisées – redéfinissent ce que le grand public considère comme de la danse urbaine. ABDC élève drastiquement le niveau technique attendu. Les crews présentent des routines qui fusionnent illusion, synchronisation militaire, acrobaties, et narration visuelle. Cette surenchère spectaculaire influence directement l’enseignement du street jazz dans les studios : les élèves veulent apprendre les mouvements vus à la télévision, poussant les professeurs à intégrer des éléments toujours plus divers et techniques.
« So You Think You Can Dance », lancée en 2005, joue un rôle différent mais tout aussi crucial. L’émission présente le hip-hop et le street jazz aux côtés du ballet, du contemporain et des danses de salon, forçant les danseurs à maîtriser plusieurs styles. Des chorégraphes comme Tabitha et Napoleon D’umo (Nappytabs), Marty Kudelka, et Christopher Scott deviennent des noms familiers, et leurs pièces, souvent narratives et techniquement exigeantes, établissent de nouveaux standards pour ce que peut être le street jazz sur scène.
Ces émissions créent également un nouveau type de danseur : polyvalent, capable de passer du hip-hop au contemporain, du street jazz au ballet, maîtrisant plusieurs vocabulaires corporels. Cette hybridité devient la norme dans l’industrie professionnelle. En France, « Danse avec les Stars » et d’autres formats similaires, bien que centrés sur les danses de salon, incluent progressivement des numéros de street jazz et hip-hop, contribuant à la légitimation de ces formes auprès du grand public.
 Les grands chorégraphes de l’ère contemporaine
Les grands chorégraphes de l’ère contemporaine
La génération de chorégraphes émergeant dans les années 2000-2010 redéfinit complètement le street jazz, créant des styles personnels immédiatement reconnaissables.
• Parris Goebel, chorégraphe néo-zélandaise d’origine samoane, explose sur la scène internationale dans les années 2010. Fondatrice du crew The Royal Family et du ReQuest Dance Crew, elle développe un style féroce, athlétique et profondément féminin qui célèbre la puissance des femmes de couleur. Ses chorégraphies pour Justin Bieber (« Sorry », 2015), Jennifer Lopez (performance au Super Bowl 2020), et Rihanna fusionnent street jazz, hip-hop et influences polynésiennes avec une précision militaire et une énergie explosive. Goebel place également la dimension politique au cœur de son travail, affirmant fièrement son identité de femme samoane queer dans une industrie souvent dominée par des normes occidentales.
• Kyle Hanagami émerge dans les années 2010 avec un style ultra-précis, presque robotique, qui fusionne popping, animation, et jazz commercial. Ses tutoriels YouTube attirent des millions de vues, faisant de lui l’un des enseignants les plus influents de sa génération. Sa chorégraphie virale sur « Fake Love » de BTS démontre sa capacité à créer des mouvements à la fois accessibles et techniquement sophistiqués.
• Janelle Ginestra développe un style féminin, fluide et émotionnel qui marie sensualité et force. Directrice créative pour WilldaBeast Adams, elle forme une génération de jeunes danseurs à travers l’ImmaBEAST company. Son approche met l’accent sur la connexion émotionnelle au mouvement, pas seulement sur la prouesse technique.
• Keone et Mari Madrid apportent une dimension narrative et théâtrale au street jazz. Leur travail, souvent créé en collaboration en tant que couple, fusionne contemporary, hip-hop et street jazz pour raconter des histoires complexes. Leurs pièces pour « World of Dance » et leurs chorégraphies pour des artistes comme Billie Eilish démontrent qu’il est possible d’être techniquement excellent tout en restant artistiquement profond.
• Matt Steffanina devient l’un des chorégraphes les plus suivis sur YouTube dans les années 2010. Ses tutoriels de danse, décomposant des chorégraphies sur des hits pop contemporains, permettent à des millions de personnes d’apprendre le street jazz depuis leur salon. Cette démocratisation de l’apprentissage transforme la façon dont les gens accèdent à la danse.
• Jonte’ Moaning apporte une perspective ouvertement queer au street jazz, créant un espace pour la femininity et la voguing house dans un monde souvent dominé par la masculinité traditionnelle. Son style – mélange de voguing, de jazz commercial et de waacking – élargit la définition de ce que peut être le street jazz.
La codification pédagogique
Les années 2000-2020 voient une codification pédagogique sans précédent du street jazz, transformant une pratique informelle en discipline enseignable de manière systématique.
Les grandes conventions de danse (Pulse, Radix, JUMP, Velocity) établissent des programmes structurés avec des niveaux de progression clairs. Des terminologies standardisées émergent pour nommer les mouvements : le « body roll », le « chest pop », le « hip roll », les « shoulder shimmies », les « waves » deviennent un vocabulaire partagé à travers le monde. Des organismes de formation professionnelle commencent à offrir des certifications en street jazz. En France, des écoles comme le Studio Harmonic à Paris ou Dansity à Lyon développent des cursus complets combinant technique, théorie et histoire. Les diplômes d’État (DE) de danse en France reconnaissent progressivement le hip-hop comme discipline à part entière, bien que le street jazz reste dans une zone grise entre hip-hop et jazz.
YouTube révolutionne l’apprentissage. N’importe qui avec une connexion internet peut désormais apprendre auprès des meilleurs chorégraphes mondiaux. Cette démocratisation accélère la diffusion des styles mais crée aussi une homogénéisation : les mêmes chorégraphies virales sont apprises simultanément à Seoul, Paris, Los Angeles et São Paulo. Les réseaux sociaux transforment aussi la façon dont la danse circule. Instagram et TikTok créent de nouvelles formes de chorégraphies, courtes, percutantes, conçues pour être virales. Le « Renegade », le « Savage », et d’innombrables autres danses TikTok empruntent au vocabulaire du street jazz tout en le simplifiant pour une consommation de masse.
 L’influence de la K-pop et de la pop mondiale
L’influence de la K-pop et de la pop mondiale
L’émergence de la K-pop comme force dominante dans la musique pop mondiale transforme profondément le street jazz. L’industrie coréenne, avec sa formation intensive de trainees (apprentis-artistes) qui apprennent le chant, la danse et la performance pendant des années avant de débuter, élève les standards de performance à un niveau inédit.
Des groupes comme BTS, BLACKPINK, EXO, TWICE, et Stray Kids ne se contentent pas de chanter : ils sont des danseurs accomplis qui exécutent des chorégraphies d’une complexité et d’une synchronisation époustouflantes. Les chorégraphes travaillant dans la K-pop – Lia Kim (1MILLION), Kiel Tutin, Kyle Hanagami, Sienna Lalau – fusionnent street jazz, hip-hop, waacking, voguing et éléments contemporains dans des productions visuellement spectaculaires. 1MILLION Dance Studio à Seoul devient un centre mondial du street jazz. Leurs vidéos YouTube accumulent des centaines de millions de vues. Des chorégraphes comme Lia Kim, May J Lee, Mina Myoung, et Isabelle développent des styles personnels qui influencent la danse mondiale. Leur approche, ultra-précise, visuellement captivante, avec une qualité de mouvement qui alterne entre fluide et sharp, définit l’esthétique du street jazz des années 2010.
L’influence coréenne apporte plusieurs innovations : une attention obsessive aux détails, l’utilisation créative de formations et de transitions de groupe, l’intégration d’éléments de mode et de styling dans la performance, et une production vidéo de très haute qualité qui transforme chaque chorégraphie en œuvre d’art visuelle. La K-pop crée également un modèle économique nouveau où les chorégraphies deviennent des propriétés intellectuelles précieuses. Les « dance practices » (vidéos de répétition) et les « dance challenges » sur les réseaux sociaux engagent les fans globalement, créant une culture participative où des millions de personnes apprennent et reproduisent les mêmes chorégraphies.
D’autres scènes pop mondiales suivent ce modèle. La pop latino, avec des artistes comme Bad Bunny, J Balvin, et Rosalía, intègre ses propres éléments chorégraphiques, mélangeant reggaeton, street jazz et références culturelles locales. La pop japonaise et la scène afrobeats nigériane apportent leurs propres influences, créant un écosystème global de street jazz aux multiples facettes.
L’évolution stylistique et les sous-genres
Au fil des décennies 2000 et 2010, le street jazz éclate en de multiples sous-genres, chacun avec ses propres caractéristiques et communautés.
• Le street jazz commercial : C’est le style le plus visible, celui des clips vidéo, des tournées de pop stars, et des grandes productions. Il se caractérise par des chorégraphies hautement polies, des formations complexes, et une énergie accessible au grand public. Les danseurs comme les Jabbawockeez, les Kinjaz, et les membres de crews commerciaux maîtrisent cette forme.
• Le street jazz féminin : Des chorégraphes comme Yanis Marshall (spécialisé dans la danse en talons hauts), Nicole Kirkland, et Aliya Janell (créatrice de Queens N’ Lettos) développent un style qui célèbre la féminité puissante, la sensualité confiante, et la technique en talons. Ce sous-genre, particulièrement populaire dans les cours pour adultes, réclame un espace pour l’expression féminine dans une culture souvent dominée par l’esthétique masculine.
• Le lite feet : Émergeant du Bronx dans les années 2000, ce style ultra-rapide de footwork est dansé sur de la musique jersey club. Caractérisé par des mouvements de jambes d’une vitesse hallucinante, le lite feet représente la continuation de l’innovation de rue, prouvant que les communautés urbaines continuent de créer de nouveaux styles.
• L’animation et le turfing : Sur la côte Ouest, l’animation (créer des illusions de stop-motion avec le corps) et le turfing (style de Oakland caractérisé par des mouvements storytelling et mimétiques) évoluent en formes de plus en plus sophistiquées. Des danseurs comme Dragon (de YAK Films) et Turf Feinz poussent ces styles vers de nouveaux sommets techniques.
• Le street jazz lyrique : Certains chorégraphes fusionnent le street jazz avec le contemporary et le lyrique, créant des pièces émotionnellement chargées qui utilisent le vocabulaire urbain pour exprimer des sentiments profonds. Cette hybridation trouble encore davantage les frontières entre genres.
• Le flexn : Né à Brooklyn dans les années 2000, le flexn (ou bone breaking) avec ses contorsions extrêmes et ses mouvements qui semblent défier l’anatomie humaine, représente l’avant-garde de l’innovation urbaine. Popularisé par Reggie « Regg Roc » Gray et Flizzo, ce style montre que la rue continue d’être un espace de création radicale.
La mondialisation et les scènes régionales
Le street jazz du XXIe siècle est véritablement global, avec des scènes vibrantes sur tous les continents.
L’Asie, particulièrement le Japon, la Corée du Sud, et la Chine, devient un centre majeur. Au Japon, des danseurs comme Shingo Okamoto, Risa, et Genta Enomoto développent un style caractérisé par une précision extrême et une musicalité sophistiquée. Les battles japonais, comme Dance Delight et Legend Tokyo, attirent les meilleurs danseurs mondiaux. L’Europe développe ses propres identités régionales. En France, des compagnies comme Wanted Posse, Pockemon Crew, et des chorégraphes comme Bintou Dembélé fusionnent street jazz avec danse contemporaine et références africaines. Le Royaume-Uni, avec sa scène grime et garage, crée des styles comme le skanking qui influencent le street jazz britannique. L’Allemagne, les Pays-Bas, et l’Italie développent leurs propres écoles et esthétiques.
L’Océanie produit des talents exceptionnels, particulièrement en Nouvelle-Zélande avec Parris Goebel et en Australie. Les influences polynésiennes – l’importance du groupe, la puissance physique, le storytelling – créent une saveur distincte du street jazz océanien.
L’Amérique latine intègre ses propres traditions. Le street jazz brésilien incorpore des éléments de samba et de passinho, le street jazz mexicain dialogue avec les traditions de la danse folklorique, créant des hybrides culturels fascinants. Cette mondialisation crée un réseau complexe d’influences croisées. Un chorégraphe français peut s’inspirer d’un style coréen qui lui-même s’inspire du popping californien des années 1970. Les frontières deviennent poreuses, les influences multidirectionnelles.
 L’impact commercial et les opportunités professionnelles
L’impact commercial et les opportunités professionnelles
Le street jazz contemporain génère une économie substantielle. Les danseurs professionnels travaillent dans une industrie diversifiée : clips vidéo, tournées mondiales, publicités, films, émissions télévisées, casinos de Las Vegas, parcs à thème, événements corporatifs.
Des compagnies commerciales comme ImmaBEAST (fondée par WilldaBeast Adams), The Kinjaz, et Quest Crew fonctionnent comme des entreprises, offrant non seulement des performances mais aussi des workshops, des camps d’été intensifs, et du merchandising. Certains chorégraphes gagnent des revenus substantiels grâce aux vues YouTube et aux partenariats avec des marques. Les conventions de danse sont devenues des événements massifs. JUMP, The Pulse, NUVO, 24Seven attirent des milliers de jeunes danseurs qui paient plusieurs centaines de dollars pour des week-ends intensifs de formation. Ces conventions fonctionnent selon un modèle commercial sophistiqué, vendant non seulement des cours mais aussi des photos, des vidéos, et l’opportunité de « danser avec » ou « d’être vu par » des chorégraphes célèbres.
Des bourses et des programmes de mentorat émergent. Des organisations comme The Bloc (New York) et Debbie Allen Dance Academy (Los Angeles) offrent des formations abordables ou gratuites aux jeunes des quartiers défavorisés, tentant de préserver l’accès à la danse pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les studios privés coûteux.
Les tensions et débats contemporains
Cette période n’est pas sans controverses et tensions qui reflètent des problématiques sociétales plus larges. L’appropriation culturelle reste un débat central. Alors que le street jazz a des racines profondément afro-américaines, de nombreux chorégraphes et danseurs célèbres sont blancs ou asiatiques. Des questions émergent : qui a le droit de créer et de profiter économiquement de ces formes ? Comment créditer et compenser les innovateurs originaux ? Ces débats s’intensifient sur les réseaux sociaux, où des communautés demandent plus de reconnaissance et de compensation pour les créateurs noirs.
Le street jazz commercial favorise souvent certains types de corps, minces, athlétiques, jeunes. Des mouvements émergent pour élargir la représentation, célébrant la diversité des corps, des âges, et des capacités physiques. Des chorégraphes comme Sherrie Silver (chorégraphe du « This is America » de Childish Gambino) utilisent leur plateforme pour célébrer l’afrocentrisme et contester les normes esthétiques occidentales.
Alors que le street jazz naît dans les communautés défavorisées, sa professionnalisation l’a rendu coûteux. Les cours en studio, les conventions, les costumes de compétition, les voyages créent des barrières financières. Cette gentrification de la danse urbaine soulève des questions éthiques : la culture est-elle en train de s’éloigner de ceux qui l’ont créée ?
